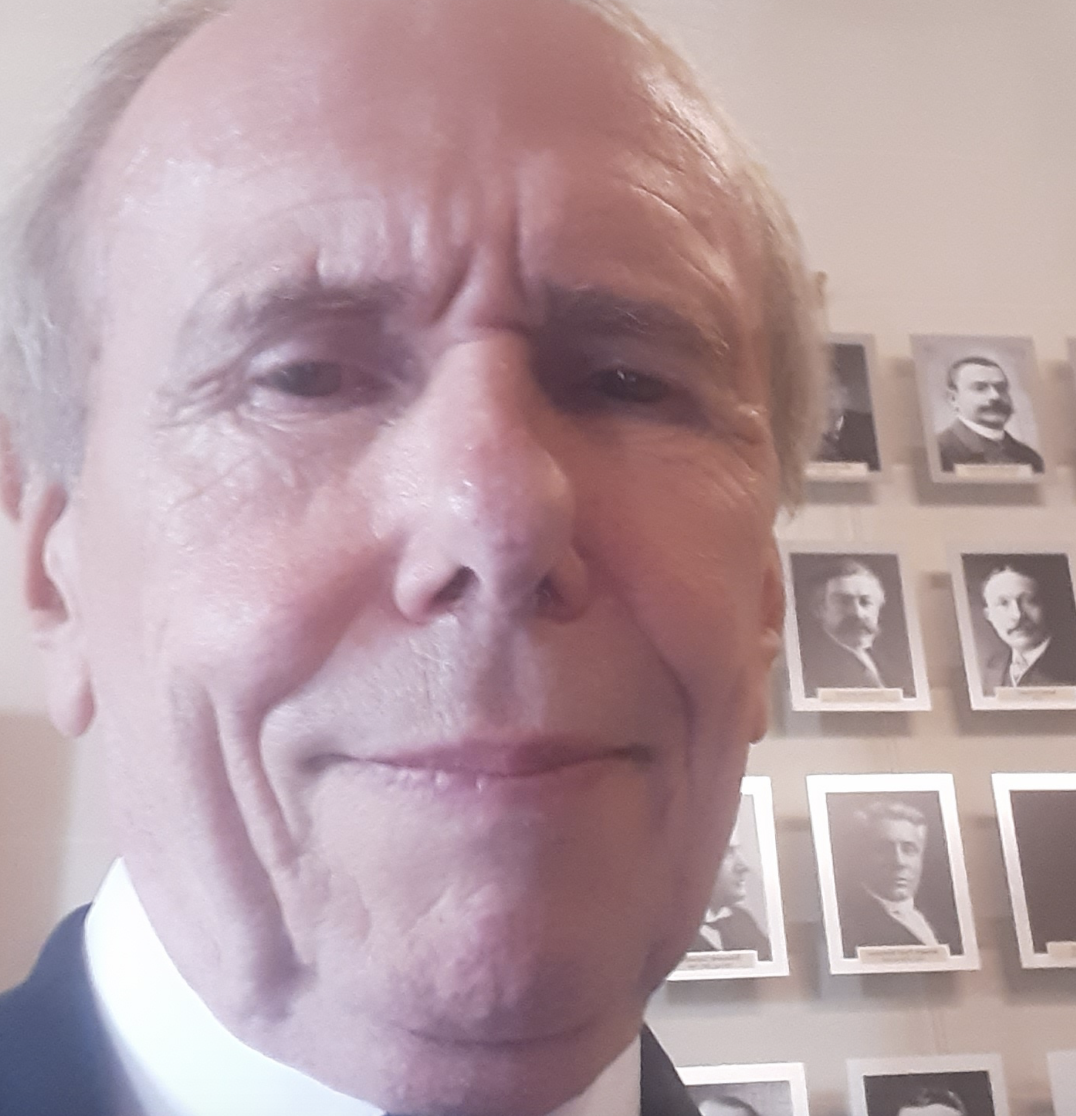
Pierre Pougnaud, né en 1947, ancien élève de l’Ecole nationale d’Administration (1971), membre (n. r.) de l’Académie des Sciences, Arts et Belles-lettres de Dijon, France, est président en exercice du Collège européen des experts en administration publique (CEEAP / ECEPA), président d’honneur du Forum d’échanges et de rencontres administratifs mondiaux (FERAM) et vice-président exécutif du think-tank GLOBAL LOCAL FORUM.
Dans des temps «normaux », l’année 2024 qui vient de s’achever aurait pu être, pour la communauté internationale, l’occasion de célébrer le Tricentenaire de Kant, auteur en son temps d’un plan de paix perpétuelle. Or, à part dans quelques cercles académiques qui au demeurant n’ont pas insisté sur l’aspect « diplomatique » de son œuvre et la faisabilité de ses recommandations, cet anniversaire est passé presque inaperçu tant les conflits à haute intensité occupaient nos esprits et tant les perspectives de retour à une situation plus stable apparaissaient lointaines. Pourtant, la prévalence des guerres ne doit pas faire oublier la recherche des moyens d’une nouvelle cohabitation planétaire, au premier rang desquels figure la diplomatie. Pour cela, il convient de retrouver les instruments et pratiques qui ont pu être mis de côté à l’époque où certains prédisaient, ou même appelaient de leurs vœux, la fin de l’Histoire dans une convergence heureuse.

Alors que l’on pouvait espérer, encore vers les années 2010, qu’une « dynamique des fluides » puisse se substituer à « une tectonique des plaques », selon l’expression du manifeste de Global Local Forum, c’est visiblement ce second terme qui décrit le mieux, bien qu’il faille le regretter, la situation actuelle. A un monde multipolaire souhaité à la fin du dernier siècle pour éviter une hégémonie universelle, on assiste bien plutôt à la constitution d’une multipolarité de fait subie, avec la constitution de blocs, empires ou zones d’influence, et mais celle-ci est à première vue porteuse de tensions plutôt que de détente. C’est bien à une « dérive des continents » que nous assistons, accompagnée d’une contestation parfois très virulente des valeurs de l’Universel.
« LES FORMATS DE LA PAIX »
Les apôtres et les promoteurs de la multipolarisation du monde ont pour premier souci apparent de déconstruire les formats qui leur paraissent procéder d’une domination occidentale. Ainsi, ils contestent aussi bien celui du G 7 que celui du G 20, et à certains égards des institutions plus permanentes, comme l’OCDE qui leur semble être l’instrument de prescriptions unilatérales en matière de développement ou, à moindre degré, les agences des Nations Unies ou les institutions de Bretton Woods, voire même quelquefois – paradoxe suprême – leurs propres organisations de coopération sous-régionale, comme on le voit actuellement au sein du continent africain.
Et les évolutions les plus récentes montrent bien qu’au sein même des BRICS, qui ont organisé leurs enceintes de concertation et de plaidoyer, les intérêts géographiques et économiques les amènent dans la pratique à prendre souvent des positions divergentes dès qu’il s’agit d’enjeux économiques ou de sécurité, dès qu’il s’agit de se positionner par rapport aux stratégies à adopter vis-à-vis des évolutions climatiques ou écologiques. Cela évoque – avec souvent le talent des dirigeants en moins – l’époque du non-alignement de Nehru, de Soekarno, de Nasser ou de Tito. Mais on sait comment cette solidarité de ceux qui se mobilisaient autour d’un establishment mondial a éclaté au profit de replis sur des proximités de zone, souvent plus génératrices de conflits que de coopérations et de plus comportant des risques de contagion, de déstabilisation en chaîne par des mécanismes pervers de solidarité en cascade avec les belligérants.
Il est essentiel de susciter des procédures de conciliation et de créer des points de rencontre, des lieux francs où l’on puisse se retrouver pour faire fonctionner des mécanismes bien connus des historiens de la diplomatie et quelque peu oubliées dans la pratique actuelle des gouvernements et de leurs chancelleries : médiation, « ligues des neutres », bons offices… En effet, on ne peut raisonnablement croire que la paix puisse être ramenée par le seul effet de mécanismes de sanctions ou par un règlement juridictionnel, dont le principe même n’est pas universellement reconnu. Et il y a place pour un travail conjoint des diplomates, des jurisconsultes, de la communauté du savoir.
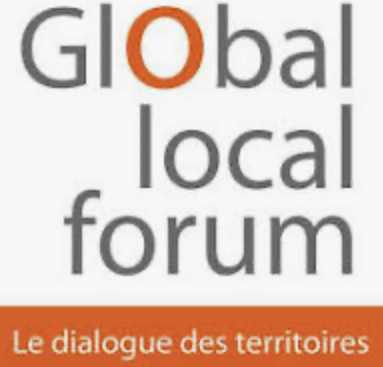
La devise de la diplomatie devrait être : «Soyons prêts à tout…même à la paix ». Imaginons, pour prendre un exemple et comme l’annoncent certains, que le conflit russo-ukrainien puisse donner lieu « à partir du 20 janvier 2025 » ( ?) à un déblocage politique de principe entre les dirigeants intéressés au plus haut niveau. Quand bien même cela serait, et sous réserve de l’acceptabilité dans la durée par un peuple victime d’une agression, les termes concrets d’un règlement nécessitent une mise au point juridique et technique très compliquée sous la forme d’une Conférence de la paix et de travaux d’experts : des sujets tels que la suite à donner au processus incomplet amorcé en 2014 sur la situation de la Crimée, la liberté de circulation maritime en mer d’Azov, le droit pour l’Ukraine d’adhérer à la zone de coopération de son choix, le respect des spécificités linguistiques et religieuses dans l’est du pays, l’instauration de zones franches ou démilitarisées, l’indemnisation des dommages sont autant de thèmes qui nécessitent la conciliation de principes parfois contradictoires du droit international.
Et, si toutes les bonnes volontés sont les bienvenues, y compris par des initiatives africaines, asiatiques ou d’Amérique latine dont certaines se sont déjà pré-positionnées, il est essentiel que cette expertise ne soit pas monopolisée par des « faciliteurs » étrangers au continent européen relevant de la seule stratégie de grandes puissances, l’Union européenne restant cantonnée dans son rôle habituel d’agent payeur des reconstructions, comme cela a été lors des accords d’Oslo. Ces négociateurs auront à discuter avec des interlocuteurs habiles, comme Lavrov, ce Talleyrand russe à qui ses autorités ont fait jouer à la fois…le rôle de Molotov et celui de Ribbentrop ! Des négociateurs capables à la fois de cynisme et d’un légalisme formel quand il s’agit de faire appel à des principes des Nations Unies comme celui de la non-ingérence. Sommes-nous sûrs de faire le poids dans ce contexte ? Il est permis d’en douter. Mais des moyens existent pour se remettre à niveau et pouvoir être utiles en temps utile.
GARDER LES TRADITIONS, REMETTRE EN CAUSE LES HABITUDES
La diplomatie est souvent considérée comme un jeu élitiste mené par des esthètes déconnectés de leur réalité nationale et insuffisamment conscients des forces qui agitent le monde contemporain. Elle est pourtant incontournable et, de plus, un facteur de continuité dans les démocraties qui sont actuellement affectées d’une instabilité gouvernementale, pour qu’elles se trouvent sur un pied d’égalité avec les régimes autoritaires sans avoir à sacrifier leur idéal.

Traditionnellement, on distingue diplomatie de posture, diplomatie d’influence et diplomatie de négociation.
De fait, trop souvent seuls les deux premiers volets de l’activité diplomatique ont été couramment privilégiés dans la période récente, alors que le troisième n’était mis en valeur que dans des circonstances exceptionnelles ou, à l’opposé, réservé au quotidien des échanges de lettres et des arrangements administratifs. Or, vite sont atteintes les limites de la diplomatie publique surtout quand elle se manifeste sur le mode de l’instantanéité, voire du culte de la personnalité. Entre l’arrogance et la gaffe, le chemin est étroit et les avantages que l’on tire à commenter à chaud une situation sont très minces par rapport aux difficultés qui aussitôt en résultent.
Lorsque les autorités des Etats se mettent au même rang que les influenceurs, ils sont battus d’avance, car ils n’ont pas l’avantage du nombre et ils sont soumis à des contraintes que ces derniers n’ont pas. Certes une « no-comment line » n’est plus aussi facile à tenir qu’autrefois, sous la pression des journalistes, des organisations de société civile ou des instances parlementaires, et cela sous le prétexte légitime de la redevabilité et de la transparence. Mais la fuite en avant du bavardage, la diplomatie de la repentance et l’étalage permanent de nos complexes, procédant d’une maladroite auto-dévalorisation, ne nous valent pas, bien au contraire, le respect de nos vis-à-vis qui, au nom de l’égalité des peuples et du libre choix des modèles de développement, attendent autre chose.
Il vaut mieux agir par l’exemple que par le précepte et la mauvaise conscience, tout autant que la bonne conscience satisfaite d’elle-même, ne sont pas des voies à suivre.
Il vaut mieux de la lucidité, de la patience, une certaine distance et mener, quand on ne peut faire plus, une coopération concrète et banalisée qui vise à résoudre ensemble les problèmes du présent, y compris par de petits pas, plutôt que de chercher systématiquement à réécrire l’histoire sur la base de préalables mémoriels.
Que peut-on souhaiter dans l’organisation d’un service diplomatique « post-moderne » ?
D’abord plus de durée de séjour dans les postes, surtout pour les chefs de mission. On ne peut être influent dans son pays de résidence si on ne reste que trois ans, juste le temps de faire approuver un plan d’action qui sera mis en œuvre…par votre successeur. Certains pays – pensons à l’Allemagne ou à l’Autriche – ont des durées plus longues et mettent plus l’accent sur les liens économiques. Cela semble leur réussir.
Le « turnover » excessif procède en fait de paramètres de politiques de personnel, en raison notamment de contraintes de pyramides des âges, mais c’est raisonner à l’envers que de faire passer des considérations de commodité de gestion avant l’intérêt supérieur des tâches à accomplir.
Une autre orientation est d’être capable de nouer des contacts préalables avec des pays, pas forcément du même continent, susceptibles de devenir nos alliés de circonstance sur des dossiers particuliers, afin de former des coalitions à la demande dont nous pouvons être les inspirateurs, à défaut d’en être toujours les instigateurs.
Pour un Etat qui n’a pas de vocation hégémonique et qui se place sur les terrains de la persuasion et de la coopération, on peut être singulier dans ses approches mais il faut éviter d’être isolé. Une diplomatie moderne ne doit pas avoir de vanité d’auteur et il vaut mieux contribuer à faire circuler une idée, y compris dans des enceintes multilatérales que de vouloir à tout prix en assumer la paternité.
Une diplomatie plus démultipliée.
Enfin, il convient de mettre en œuvre une diplomatie plus démultipliée, idée qui s’est faite jour à partir de 2013 et qui recouvre notamment la diplomatie parlementaire et la diplomatie des territoires, sous ses différentes formes que sont le plaidoyer des autorités régionales et locales d’une part, la coopération décentralisée de l’autre.
Sous ces réserves et à ce prix, Il y a plus que jamais une place pour une diplomatie qui soit professionnelle sans céder aux attraits du corporatisme, qui sache utiliser des procédures codifiées au service d’initiatives innovantes et puisse écouter ceux qui sont porteurs de l’expertise de paix.
Pierre POUGNAUD