
Entretien de Jean-Claude Mairal, coprésident de I-Dialogos, avec Nicolas Leymonerie, responsable du Centre Francophone Antenne de Dalat au Vietnam et membre du bureau du Réseau international des Maisons des francophonies (RIMF).
I-Dialogos : Nicolas Leymonerie, vous avez près de 20 ans de vietnamophonie, 13 ans d'enseignement du français en vietnamien et une formation comme enseignant du vietnamien à l'Université des sciences humaines et sociales de Ho Chi Minh-ville. Qu’est-ce qui vous a amené à vous intéresser au Vietnam et à vous installer à Dalat pour fonder un centre Francophone ? Pourquoi Dalat ?
Nicolas Leymonerie: D’abord, ce qui m’a amené au Vietnam c’est le 13ème arrondissement de Paris où j’avais trouvé un travail en alternance avec mes études. De fil en aiguille, j’ai fait connaissance avec la diaspora vietnamienne, puis avec mon épouse hanoïenne qui était alors étudiante. C’est donc par elle que j’ai découvert le Vietnam, moi qui n’avais jamais été très loin de l’Hexagone.
Il s’est avéré que j’étais particulièrement « vietnamo-compatible » ce qui a largement facilité mon assimilation : j’ai très vite saisi les tonalités de la langue et j’avais une affinité naturelle pour les valeurs traditionnelles du Vietnam.
L’installation à Dalat fut un choix important, un vrai coup de cœur. Ses paysages vallonnés, me rappelant ceux de mon enfance en Limousin, ses clochers, ses jardins fleuris, ses maisons à colombages,... ce métissage franco-vietnamien profond qui fait encore la spécificité de cette capitale des Hauts plateaux et de ses habitants qui, dit-on, ont pour réputation d’être doux, accueillants et distingués, couplé à une qualité et un confort de vie sans pareil, ont été des facteurs déterminants en faveur de notre installation ici.
Enfin, c’est la francophilie locale qui nous a poussé à fonder un centre francophone, que nous avons toujours voulu comme un lieu de maintien et de renforcement des relations entre Dalat et la France, mais aussi la Francophonie en général. Ainsi, très vite après être arrivé à Dalat, l’Université Yersin m’a demandé de participer à son club de français et les Dalatois francophones me répétaient sans cesse qu’ils n’avaient plus d’endroit pour pratiquer la langue de Molière. Il nous a fallu attendre cinq ans l’opportunité de créer la structure.

I-Dialogos : Quel est l’accueil des autorités locales et de la population vis-à-vis de votre centre ? Quel est son rayonnement parmi la jeunesse ?
Nicolas Leymonerie: Notre centre francophone est le premier, et toujours le seul, de la province de Lâm Dong, ainsi les autorités ont toujours été bienveillantes vis-à-vis de nos activités sans pour autant y apporter un soutien direct.

Aussi, il m’a été souvent dit que la culture française étant dans l’essence même de la ville (créée ex-nihilo suite à la découverte du haut plateau du Langbian par Alexandre Yersin), ne serait-ce que pour son image touristique, il est nécessaire de la valoriser.
La population a réagi de manière assez impressionnante à la création de notre centre. Les classes de français de l’école primaire au lycée, reliquat du programme des classes bilingues de la fin des années 90, voyaient leurs effectifs décroître inexorablement et étaient menacées de fermeture.
La création du centre francophone a eu pour effet de regonfler ces effectifs dans les trois établissements scolaires. On peut dire que nous avions répondu à une attente et redonné foi en la langue française. Son rayonnement dans la jeunesse se fait principalement à travers ces établissements et leurs classes de français qui fournissent en grande partie les apprenants de notre centre, venus se perfectionner.
La langue française rayonne toujours par son prestige culturel et le fait qu’elle soit présente dans de nombreuses familles depuis des générations. Le bémol est que nous ne sommes qu’une petite flamme précaire fonctionnant essentiellement sur notre propre bénévolat et le soutien d’associations, alors que le soleil de la Francophonie n’y brille jusqu’à présent que par intermittence en raison de l’absence d’une structure plus importante à Dalat.
I-Dialogos : Vous voulez faire évoluer votre centre avec l’ambitieux projet de la Maison Alexandre Yersin. Pourquoi cette appellation ? Vous avez lancé ce projet, il y a seulement quelques mois. Où en êtes-vous ? Avez-vous reçu un accueil favorable des autorités vietnamiennes ? Et françaises ?
Nicolas Leymonerie: La francophonie dalatoise était subventionnée annuellement par la France et la Francophonie jusqu’à la crise financière mondiale des années 2007-2008 qui amenèrent à rétracter le rayonnement culturel au Vietnam comme ailleurs dans le monde.
Avant cela, les professeurs de français de Dalat recevait des primes (ce qui encouragea la formation de nouveaux enseignants) et il existait un cercle francophone disposant de matériel informatique, d’une bibliothèque et d’une documentaliste. Tout cela avait été abandonné quand nous sommes arrivés à Dalat car la ville, d’une manière qui m’a toujours paru injuste pour diverses raisons, a été exclue des villes vietnamiennes bénéficiant d’un intérêt prioritaire.
Notre objectif, dès 2013, a toujours été de créer une structure digne de reprendre le flambeau et de répondre aux enjeux actuels, comme je l’évoquais précédemment. Le plan du centre francophone Antenne a toujours été d’évoluer en une structure publique ou semi-privée par l’appui des institutions francophones basées au Vietnam.
 Ville de Da Lat (wikipedia)
Ville de Da Lat (wikipedia)
Tout un écosystème francophone est en attente d’épanouissement à Dalat dans les domaines de l’éducation, de la culture, de l’agroalimentaire, de la technologie, de la médecine… tous étant des domaines qui furent chers à celui qui est considéré comme le père fondateur de la ville, Alexandre Yersin.
En 2018, nous avions inauguré la Maison de la francophonie de Dalat mais, malgré une certification comme centre d’examen, le soutien institutionnel manquait et la pandémie de Covid-19 nous a coupés dans notre élan. Il y a quelques mois, nous avons donc lancé une ultime mise-à-jour de notre projet d’origine sur lequel nous mettons dix années de travail en jeu. Nous l’avons appelé Maison Alexandre Yersin du nom de ce Franco-Suisse, naturalisé vietnamien à titre posthume, polymathe et humaniste qui incarne comme une évidence la mission que nous avons toujours souhaité remplir à travers nos divers engagements.
Ce projet a été présenté d’abord aux institutions francophones les plus concernées, à notre réseau d’associations et à des personnalités influentes. Nous avons lancé un appel à un soutien sous forme de pétition qui a reçu l’appui de signatures prestigieuses s’agissant de Francophonie et de Yersin.
Par un heureux concours de circonstances, l’Ambassadeur de France, le directeur du bureau Asie-Pacifique de l’OIF et le Président du GADIF à Hanoï, en la personne du représentant de la délégation générale Wallonie-Bruxelles, feront un déplacement commun à Dalat du 7 au 9 mars à l’occasion de la commémoration de la mort du Docteur Yersin et de la fête de la Francophonie.
Le sujet est sur la table. Par ailleurs, l’AFD et la CCIFV (Chambre de commerce et d’industrie franco-vietnamienne) ont prêté une oreille attentive aux opportunités qu’offrirait un tel bureau d’assistance à la coopération francophone basé dans la capitale des Hauts plateaux, notamment pour ce qui est du ferroviaire, du nucléaire et du tourisme, en relation avec le développement durable.
En ce qui concerne les relations extérieures, les autorités locales ne sont pas accoutumées à la prise d’initiatives, mais elles sont ouvertes aux propositions qui favoriseraient le développement économique et des relations internationales amicales. 
I-Dialogos : le projet Maison Alexandre Yersin est très intéressant et mérite que l’on vous appuie. Que peut-on faire pour cela ?
Nicolas Leymonerie: Les conditions au Vietnam font qu’il nous est apparu que seule une institution francophone ayant droit d’exercer des activités de coopération dans la province de Lâm Dông pourrait concrètement aider à la création de la Maison Alexandre Yersin à Dalat.
Il n’est pas envisageable de créer une association, et un centre francophone est limité par son statut uniquement pédagogique.
Nous avions accompagné pendant cinq ans la signature d’une coopération entre l’Occitanie et le Lâm Dông qui, bien que réalisée en 2021, a été parfaitement stérile jusqu’à la fin de l’accord l’année dernière.
Une occasion manquée qui a englouti beaucoup d’énergie et d’espoir en vain alors qu’elle aurait pu être exemplaire et mener à la création d’un tel projet. Ainsi, à l’heure actuelle, il s’agirait de convaincre les instances francophones, habilitées à agir en la matière, de l’importance de l’intégration pleine et entière de Dalat au sein des actions de coopération culturelle et économique, et de convaincre les entreprises et les grands groupes qu’il y a là des opportunités à saisir.
L’idée d’une coopération décentralisée ou d’un jumelage serait aussi à remettre à l’ordre du jour, avec la France, la Suisse ou tout autre pays de la Francophonie.
I-Dialogos : Même si c’est lié à la colonisation et qu’il y a eu une guerre entre les deux pays, les liens de la France avec le Vietnam sont anciens. Où en sont actuellement ces liens ? Je ne parle pas des liens politiques, mais des liens culturels, des liens par la langue ? Comment se situe la langue française ? Son enseignement dans le pays ?
Nicolas Leymonerie: Oui, les liens entre la France et le Vietnam sont même très anciens, en atteste la chaise à porteurs offerte par Louis XVI au fondateur de la dynastie impérial des Nguyen, ou, plus anciennement encore, à l’implication du jésuite Alexandre de Rhodes dans la première standardisation de l’écriture latine du vietnamien au XVIIème siècle.
À présent, la France et le Vietnam ont fêté en 2023 les 50 ans de leurs relations diplomatiques et les 10 ans de leur partenariat stratégique. Ce partenariat est devenu global en octobre dernier, lorsque le secrétaire général du PCV, qui cumulait alors avec le poste de Président du pays, s’est rendu à Paris à l’occasion du Sommet de la Francophonie, une première !
Comme cela a été annoncé par l’Ambassadeur de France au Vietnam, M. Olivier Brochet, il faut s’attendre à des visites diplomatiques de très haut niveau cette année 2025.
La venue d’une délégation de la SNCF pour étudier le projet de Ligne à grande vitesse Nord-Sud en janvier au Vietnam est aussi un facteur encourageant pour les relations futures et notamment vis-à-vis de l’enseignement du français. Car, pour répondre plus précisément à la question, l’économique et le culturel vont de pair.
C’est d’ailleurs la principale raison de la prépondérance de l’anglais. Le français tient toutefois une place majeure au Vietnam. Selon un rapport du ministère de l’éducation de 2023, il y avait environ 60 000 apprenants de l’anglais, 30 000 de français, 20 000 de japonais et 15 000 de chinois.
Le français est donc la deuxième langue étrangère la plus apprise au Vietnam qui est le pays d’Indochine ayant la population francophone la plus grande en valeur absolue, et c’est ici que se trouve la représentation institutionnelle de la Francophonie en Asie (OIF et AUF).
Mais la francophonie au Vietnam, ce n’est pas seulement l’usage du français. La langue vietnamienne fait partie selon moi des « langues de la Francophonie » en ce que son vocabulaire, sa prononciation, sa syntaxe, ses expressions et sa littérature ont été imprégnées de langue française. Pour cette raison, la culture et la langue française constituent en partie la culture et la langue du Vietnam moderne, et cela participe de son particularisme régional et, j’en suis convaincu, du renforcement de sa souveraineté. Il est d’ailleurs étonnant de constater que le Vietnam a conservé des pans de culture française que la France perd elle-même par sa modernisation et l’influence américaine.
I-Dialogos : Nous pensons que l’intérêt de la France, c’est de favoriser et de promouvoir des coopérations avec le Vietnam. Comment favoriser celles-ci dans nos territoires en France, avec les collectivités et les associations ? Mais également avec les communautés vietnamiennes implantées en France ? I-Dialogos qui réfléchit à cette question depuis plusieurs mois et preneur de toutes les suggestions.
Nicolas Leymonerie: D’après notre expérience, notamment avec la coopération Occitanie-Lâm Dông, il a semblé que, jusqu’à très récemment du moins, la France promouvait principalement ses relations avec le continent africain s’agissant de coopération Nord-Sud.
Il est possible suite à de récents développements géopolitiques, et de ce que j’ai pu aborder plus haut, que son regard se tourne maintenant davantage vers l’Asie du Sud-Est que ce n’était le cas ces vingt dernières années. À l’exception de grands projets de coopération dans les grands centres économiques et touristiques du Vietnam (avec Paris, Lyon, Toulouse, Côtes-d’Armor, Nouvelle-Aquitaine etc.), ce sont pour moi surtout les associations et la société civile qui maintiennent le feu sacré avec des moyens et dans des contextes de plus en plus difficiles.
Le Vietnam jouit d’un capital sympathie auprès de la France qui ne se dément pas. Moi qui n’avait pas de relation avec ce pays avant de venir à Paris, j’ai été impressionné par l’intensité des liens humains qui unissent les deux nations.
La coopération internationale au Vietnam étant très contrainte pour des raisons de souveraineté et d’indépendance, ce contexte politique favorable me semble important pour tracer le sillon de l’action des collectivités et des associations qui y trouvent là une légitimité et un couvert institutionnel.
Autrement, je remarque que la communauté franco-vietnamienne est très vivante en France.
On y trouve beaucoup d’associations et des événements culturels sont organisés régulièrement, maintenant il faut transformer les passerelles en ponts. Le pont économique est peut-être encore trop sous-estimé par la France. L’Asie du Sud-Est est le nouveau moteur économique du monde et le Vietnam en est l’une des figures de proue avec sa croissance insolente, les deux pays sont faits pour s’entendre.
Cela peut se faire par l’entreprise, mais aussi par l’emploi : la France a besoin de main-d’œuvre, le Vietnam en a (voir l’exemple de la société RP Sourcing qui s’est spécialisée dans ce domaine).
Aussi, je pense que le renforcement des relations doit se faire par le partage de la langue, mais pas seulement de la langue française. C’est ainsi que j’ai commencé à enseigner le vietnamien cette année et j’espère notamment avoir davantage de jeunes apprenants francophones d’origine vietnamienne.
Je voudrais conclure sur le sujet en informant que le prochain sommet de la Francophonie aura lieu au Cambodge en 2026, 29 ans après celui qui a eu lieu à Hanoï. Il serait opportun que les organisations françaises qui souhaitent soutenir la francophonie vietnamienne et indochinoise puissent s’impliquer dans la préparation de ce grand rendez-vous.
I-Dialogos : Présent sur l’ensemble des continents, nous sommes très intéressés par le rayonnement de la francophonie. Nous pensons en effet qu’il faut penser la francophonie à l’échelle des 5 continents et pas seulement à l’échelle de l’Afrique de l’Ouest, trop souvent perçu en France comme un relent de la France Afrique. Selon les espaces géographiques et les cultures, les spiritualités et l’Histoire propre à chacun d’eux, on doit en effet avoir une vision et une conception de la francophonie et de la langue française, différentes, selon que l’on se trouve en Afrique de l’Ouest victime de la colonisation française, au Moyen Orient, en Asie, en Europe ou aux Amériques.
Nicolas Leymonerie: Les Français parlent leur langue actuelle en raison de la colonisation romaine, puis de la colonisation franque. Les Vietnamiens parlent leur langue actuelle en raison de la colonisation chinoise, puis de la colonisation française.
Eux-même ont colonisé les royaumes cham et khmer du Centre et Sud Vietnam actuels en y imposant leur langue. C’est l’histoire de chaque nation du monde. Le Vietnam, par son pragmatisme, peut figurer comme modèle sur la question. D’abord, comme il est dit ici, « rien n’est plus important que l’indépendance et la liberté » de la nation, ceci acquis, si la Francophonie est un avantage pour le pays alors il s’en saisira (comme il l’a fait pour entrer dans le concert des nations) sinon il l’abandonnera, mais pas pour de mauvaises raisons.
Ainsi, le dialogue francophone n’est pas parasité par des considérations qui souvent relèvent plus de politiques intérieures que des intérêts objectifs des pays francophones.
Enfin, il existe peu de langues véritablement internationales : l’anglais, le français, l’arabe, l’espagnol, l’espéranto…
Chaque langue porte un modèle civilisationnel propre et permet un dialogue plus ou moins élargi avec une population plus ou moins grande. À chaque peuple de choisir librement le sous-espace international culturel auquel il préférerait adhérer en privilégiant une langue internationale ou plusieurs, voire aucune s’il préfère s’isoler.
Pour ma part, je ne peux qu’encourager un déploiement accru vers l’Extrême-Orient de ce formidable outil de collaboration internationale qu’est la langue française. Les Coréens ont très bien compris comment en tirer parti, car ce n’est pas par hasard s’ils ont rejoint l’OIF.
Avec la Chine, le Japon et d’autres, la Corée est un pays où la langue française est toujours perçue comme une langue perfectionnée, élégante… et qui fait vendre (à faire rougir ces entreprises françaises qui ne jurent que par des noms de marque anglais) !
I-Dialogos : Que pensez-vous des propos d’Alain Mabanckou qui écrit : « La littérature francophone est un grand ensemble dont les tentacules enlacent plusieurs continents... La littérature française, elle, nous l’oublions trop, est une littérature nationale. C’est à elle d’entrer dans ce grand ensemble francophone. » Ces propos sont un véritable changement de paradigme, alors que pendant longtemps, la littérature française apparaissait un peu comme le phare de la Francophonie. On peut aussi citer Tahar Ben Jelloun pour qui « La francophonie est une maison pas comme les autres, il y a plus de locataires que de propriétaires », qui par ses propos, exprime une conception universaliste de la Francophonie et pas seulement inféodée à la France.
Nicolas Leymonerie: En toute honnêteté, mon impression est assez mitigée à la lecture de ces déclarations.
S’agissant de la première, le mot « tentacules » semble renvoyer à une imagerie qui suggère une certaine violence, or si nous sommes actuellement en proie à la lecture forcée d’une langue étrangère, ce n’est certainement pas celle du français.
Pour cette dernière, au Vietnam comme ailleurs, on évoque communément l’amour et le romantisme, donc s’il y a enlacement plutôt mieux vaut-il y voir des bras. Quant à la seconde, la notion de « locataires » renvoie à une impermanence, à une dette..., au contraire, soyons tous des copropriétaires de notre immeuble francophone.
Mais sur le fond, je suis assez d’accord, la francophonie appartient à ceux qui la font vivre et se battent pour elle, pour qu’elle reste riche et belle, et non qu’elle s’appauvrisse et soit mutilée. En cela, il n’est effectivement pas certain que la France d’aujourd’hui puisse se présenter comme le phare de la Francophonie. I
I-Dialogos : La francophonie n’est-elle une autre voie pour accéder au Monde, dans une mondialisation qui est aux prises à de fortes tensions internationales ? Et comme l’indique Gilles Vigneault « La francophonie, c’est un vaste pays, sans frontières. C’est celui de la langue française. C’est le pays de l’intérieur. C’est le pays invisible, spirituel, mental, moral qui est en chacun de vous. »
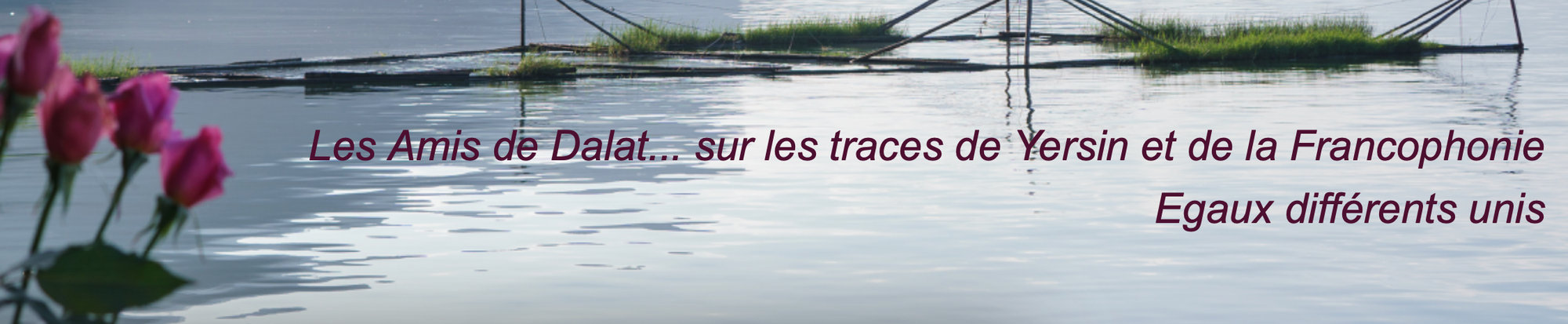 Nicolas Leymonerie: Je suis tout à fait d’accord avec cela. On peut avoir un pays charnel qui serait la France et un pays transcendant que serait la francophonie.
Nicolas Leymonerie: Je suis tout à fait d’accord avec cela. On peut avoir un pays charnel qui serait la France et un pays transcendant que serait la francophonie.
J’y vois une relation dialectique qui séduit le penchant taoïste de mon acculturation vietnamienne. De plus, c’est conforme à mon ressenti lorsque je m’adresse à des Francophones d’autres continents.
Comme je l’écrivais plus tôt, il y a un nombre restreint de langues internationales, chacune portant sa sensibilité propre et il serait dommageable que l’une d’elles s’impose sur toutes les autres. Toutes les langues, ou dialectes, sont riches d’un savoir, d’un savoir-faire, d’un savoir-vivre, leur disparition peut être aussi regrettable que la disparition d’une espèce vivante.
Il me semble que le français, autrefois langue de la diplomatie, porte en elle un vent de liberté, que ce soit la liberté des Francs face à l’empire romain ou celle des Vietnamiens face à l’empire français (rappelons ici que la plupart des héros de la résistance vietnamienne étaient de parfaits Francophones). Albert Camus disait : « Ma patrie, c’est la langue française. », et je suis heureux et fier d’avoir des centaines de millions de compatriotes en Francophonie, une Francophonie diverse où chaque citoyen n’a pas à dissoudre son identité propre dans un ensemble homogène, mais qui partage une langue et des valeurs humanistes fondamentales avec tous les autres.
I-Dialogos : Que pensez-vous des propos de Yves Bigot, président de la fondation des Alliances françaises qui écrit, dans un hors-série de L’Eléphant, « La France est le seul pays qui ne s’intéresse pas à la francophonie », ce qui fait que les Français « ne mesurent pas combien la Francophonie et la langue française sont notre force. » Pour lui, et nous y adhérons complètement, « La conscience de la force de la francophonie est notre avenir. » Et il ajoute : « Pour la nouvelle génération, la Francophonie représente un avenir culturel et géopolitique, et un futur économique crucial. » Comment faire que les citoyens, les collectivités, les associations et les entreprises françaises s’emparent et fassent leur Francophonie?
Nicolas Leymonerie: J’adhère pleinement à ces propos également et les fais miens.
Sait-on en France que le dernier sommet de la Francophonie s’est déroulé en octobre dernier à Villers-Cotterêts, 33 ans après le précédent sommet qui a eu lieu dans le pays ? 
Membres du RIMF, nous savons bien que la société civile y fut conviée d’une manière relativement dérisoire. Le phare n’a guère ébloui cette fois-là non plus. Cependant, je crois là qu’il faut bien distinguer la France en tant que peuple et la France en tant qu’État, et rendre hommage aux individus et associations qui donnent beaucoup à cette belle et noble cause. Je pense que l’Internet et la dématérialisation des échanges ont déjà largement permis aux individus et organisations françaises de participer à un nouvel élan francophone en parallèle de l’action politique.
Je n’ai évidemment pas de solution miracle, mais s’il y avait un référendum en France quant à l’orientation des subventions publiques, je serais prêt à parier que l’action politique se mettrait au diapason francophone et soutiendrait davantage les associations et entreprises concernées.
I-Dialogos : La francophonie n’a-t-elle pas trop souvent été confondue avec l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF), organisation institutionnelle?
Nicolas Leymonerie: C’est vrai et cette confusion peut poser problème dans le sens où elle biaise la perception que l’on peut avoir du monde francophone, bien plus vaste que les seuls pays adhérents à l’OIF.
Ce que l’on appelle au fond « francophonie » c’est la société civile qui s’exprime en français de par le monde.
Au RIMF, association qui souhaite justement soutenir celle-ci, nous proposons de parler également de « francophonies » pour y inclure les locuteurs de langues et parlers régionaux qui ont une affinité particulière avec la langue française.
I-Dialogos : Pour conclure notre entretien, ne serait-il pas temps de changer de logiciel concernant la Francophonie, de donner un nouvel élan à celle-ci pour construire avec les peuples et les territoires, une francophonie du 21ème siècle ?
Nicolas Leymonerie: Mieux vaut tard que jamais. La Francophonie, comme l’Union européenne, est une entité supranationale qui, plus qu’une union géographique et sociale, dispose d’une réalité linguistique qui en assure la cohésion et le développement.
Imaginons ce que pourrait aujourd’hui être la situation de la France si les efforts qu’elle a fourni pour l’UE avait été tournés vers la Francophonie, cet espace qui couvre l’ensemble de la planète avec une grande diversité et de nombreuses richesses humaines et naturelles...
Le RIMF soutient la création d’un Erasmus francophone, cela semble aller dans la bonne direction.
Da Lat, 27 février 2025