
in Transform! italia
in italiano => Guerra e pace
Né à Naples, Mario BOFFO est un Diplomate italien auteur de plusieurs romans. IL a été ambassadeur notamment au Yemen et en Arabie Saoudite. Il collabore à plusieurs revues dont LAB Politiche e Culture, partenaire de I-Dialogos.
Les guerres ne se sont jamais terminées par des « paix justes », notamment parce qu’il ne s’agit pas d’un concept absolu, mais plutôt susceptible d’être perçu de manières relativement différentes par les parties adverses. En fin de compte, il s’agit d’un concept qui relève davantage de la propagande que du concret. A la fin d'une guerre, il y a toujours quelqu'un qui a gagné et quelqu'un qui a perdu, dans les diverses déclinaisons où l'on peut lire une victoire ou une défaite. Il n’y a qu’une seule paix juste : celle qui naît du traitement diplomatique des problèmes, de l’équilibre des pouvoirs, du partage de la sécurité, de la reconnaissance mutuelle, des garanties mutuelles, de la maîtrise de l’instrument militaire nécessaire, du développement du dialogue. Ces facteurs peuvent prévenir et éviter les guerres. Ou bien ils peuvent reconstruire la paix après une guerre. Tant que la défaite est reconnue, les massacres et les dévastations ne se perpétuent pas sans issue, des visions profondes sont élaborées sur les relations entre les pays et entre les puissances, et les problèmes et les questions qui ont déclenché la guerre sont ramenés sur la table des négociations. Tout cela implique de la douleur, des compromis, des négociations longues et parfois épuisantes ; il faut aussi accepter les impositions, car il n’est pas toujours possible de négocier sur un pied d’égalité. Dans ces termes, les nombreux échecs de l’Union européenne au cours des dernières décennies sont mis en évidence, depuis qu’elle a abandonné l’approche fondée sur le dialogue qui avait été ouverte à l’époque de Gorbatchev pour s’aligner sans esprit critique sur la logique de l’élargissement autoréférentiel de l’OTAN dirigée par les États-Unis vers les frontières de la Russie. Non pas la maison commune « de Vancouver à Vladivostok », espérée par le leader historique russe, en substance, mais la chute progressive et ruineuse d’Helsinki au Donbass.

L’Europe a manqué de nombreuses occasions de croissance, de cohésion et de développement d’un rôle international non marginal ; elle aurait pu tenter de résister (même si ce n’était pas facile) à la poussée vers l’élargissement de l’OTAN, en valorisant la logique et les outils de l’OSCE, qui découlent directement du processus d’Helsinki ; elle aurait pu promouvoir avec plus de force qu’on ne l’a tenté une identité spécifiquement européenne au sein de l’Alliance atlantique ; il aurait pu lancer des paroles et des programmes de paix et de cessation des combats à la veille ou au début de la guerre en Ukraine ; aurait pu, à tout moment au cours de ces trente longues années, remettre l’accent sur la nécessité de concevoir la sécurité européenne en termes collectifs. Certes, l’Europe n’avait pas et n’a pas la force militaire ni la cohésion politique pour imposer tout cela ; mais elle aurait au moins acquis une autorité capable de lui permettre un rôle d'interlocuteur, au fil des années et maintenant, à l'heure où se poursuivent les hypothèses de cessation de la guerre en Ukraine. Il aurait pu encore aujourd'hui, malgré tout, récupérer une partie du temps et des messages politiques qui ont pu être dispersés au cours des trente dernières années, afin de regagner un minimum de crédibilité. Au lieu de cela, il a produit les cinq points tardifs qui ont émergé du dernier sommet et l’accord pour une militarisation coûteuse, risquée et non planifiée.
La déclaration du Conseil européen extraordinaire de Bruxelles du 6 mars, approuvée par vingt-six sans le consentement du Hongrois Viktor Orban, confirme les principes que les Européens reconnaissent pour parvenir à une « paix juste » en Ukraine : a) il ne peut y avoir de négociations sur l'Ukraine sans l'Ukraine ; (b) il ne peut y avoir de négociations affectant la sécurité européenne sans la participation de l’Europe ; (c) toute trêve ou tout cessez-le-feu ne peut avoir lieu que dans le cadre d’un processus conduisant à un accord de paix global ; d) tout accord de ce type doit être accompagné de garanties de sécurité solides et crédibles pour l’Ukraine, qui contribueront à dissuader toute future agression russe ; e) la paix doit respecter l’indépendance, la souveraineté et l’intégrité territoriale de l’Ukraine.

Ces principes, qui auraient été dignes d'être pris en considération et susceptibles d'influencer le cours des choses au début immédiat du conflit, sont aujourd'hui complètement dépassés par les événements, étant donné l'intention américaine de terminer la guerre de toute façon, même en opérant avec une certaine brutalité, et risquent d'apparaître hors du temps et complètement en contraste avec ce qui, qu'on le veuille ou non, se passe. En fait, l’Europe n’a aujourd’hui ni la force ni l’autorité de les mettre sur la table des négociations avec un quelconque espoir. Kiev, et peut-être l’Europe, apparaîtront probablement dans le tableau final, mais seulement après que les décisions auront déjà été prises par les acteurs de soutien américains et russes. Les principes énoncés dans les cinq points, soutenus et plus largement modulés vers le milieu des années 90, ou fermement proclamés au début de la guerre, auraient peut-être pu avoir un certain succès. Aujourd’hui, malheureusement, ils sont confrontés à une réalité désagréable, à laquelle l’Europe a contribué par son indolence de plusieurs décennies et par les positions aveugles adoptées au début du conflit armé.
Le réarmement proposé par von der Leyen souffre de la même indolence qui dure depuis des décennies. La défense européenne commune est une question importante, à laquelle il aurait fallu réfléchir dès la fin de la Guerre froide, car il était clair dès lors que les orientations sécuritaires américaines allaient progressivement s'éloigner de l'Europe (les attitudes inciviles et vulgaires de Trump ne sont que l'accélération d'un processus commencé il y a quelque temps). La défense commune n’est cependant pas une simple question de savoir combien investir dans l’armement, mais plutôt de savoir comment collaborer entre les pays, les états-majors, les industries militaires ; quelles structures intergouvernementales ou communautaires mettre en place pour la gestion de la défense ; quel concept stratégique adopter ; de la manière de nous libérer des approvisionnements américains en développant une recherche solide et collective et une production européenne commune.
Mais surtout, il nous faut savoir et décider à quoi servira la défense européenne : une Europe unie et cohésive, ou un ensemble de pays diversement unis et souvent querelleurs ? Paradoxalement, les investissements prônés par Von der Leyen, qui seront exclusivement nationaux, n’auront d’autre résultat que d’accroître les achats d’armement américains et d’anéantir complètement l’espoir de maintenir un semblant d’État-providence sur notre continent. De plus, l'Europe, armée selon les décisions adoptées à Bruxelles, compte tenu des divisions existant entre ses membres et de l'absence, si ce n'est rhétoriquement proclamée, d'une vision commune, risque d'être encore plus faible, car il n'est pas certain - jusqu'à ce qu'un véritable projet unificateur et unitaire soit enfin élaboré - que les différents membres mettent réellement en commun leurs armes pour affronter ensemble les crises du futur. Alors autant dire les choses par leur nom : nous allons augmenter les budgets militaires et acheter davantage d’armes aux Américains dans l’espoir (pas encore garanti) qu’ils ne nous abandonneront pas complètement. Pas une belle vision. Pas un gros projet.
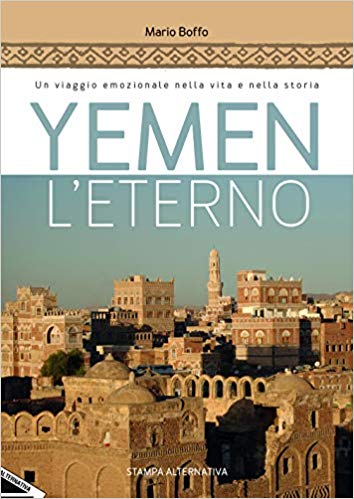 Lorsque tout va mal, il serait bon d’admettre les erreurs et de repenser les processus à mettre en place pour sortir de la confusion. Les tentatives maladroites de réparer trente années d’erreurs en quelques jours accroissent la confusion et sapent encore davantage l’autorité potentielle que l’Europe, malgré tout, mérite et qu’elle doit absolument reconstruire. Certainement pas avec les déclarations du président Macron : les deux cent quatre-vingt-dix bombes atomiques dont il semble disposer comparées aux six mille russes, ne semblent pas suffisantes pour une véritable politique de dissuasion, qui est finalement confiée non pas à un organe collectif mais à la décision discrétionnaire du président de la France lui-même. Et même pas sous la direction du Royaume-Uni, dont la trajectoire historique a toujours été d’empêcher toute croissance en Europe. L’inquiétude selon laquelle la Russie se prépare à attaquer l’Europe, et que nous devrions donc prendre des décisions d’urgence, ne semble pas non plus plausible.
Lorsque tout va mal, il serait bon d’admettre les erreurs et de repenser les processus à mettre en place pour sortir de la confusion. Les tentatives maladroites de réparer trente années d’erreurs en quelques jours accroissent la confusion et sapent encore davantage l’autorité potentielle que l’Europe, malgré tout, mérite et qu’elle doit absolument reconstruire. Certainement pas avec les déclarations du président Macron : les deux cent quatre-vingt-dix bombes atomiques dont il semble disposer comparées aux six mille russes, ne semblent pas suffisantes pour une véritable politique de dissuasion, qui est finalement confiée non pas à un organe collectif mais à la décision discrétionnaire du président de la France lui-même. Et même pas sous la direction du Royaume-Uni, dont la trajectoire historique a toujours été d’empêcher toute croissance en Europe. L’inquiétude selon laquelle la Russie se prépare à attaquer l’Europe, et que nous devrions donc prendre des décisions d’urgence, ne semble pas non plus plausible.
Certes, des inquiétudes inquiétantes pèsent sur la situation, comme la crainte d’une interruption de la couverture américaine de l’Alliance atlantique. L’Europe doit certainement s’y préparer ; elle aurait même dû commencer à s’y préparer depuis un certain temps. Mais la précipitation de ces jours n’aide pas. Voici donc cinq points alternatifs à ceux du sommet extraordinaire qui, dans la situation actuelle, seraient certainement plus productifs que ceux actuels :
- L’Europe suit de manière réaliste la cessation souhaitée des combats en Ukraine et s’engage, à partir de cette cessation, à entamer un large dialogue avec les États-Unis, la Russie et l’Ukraine elle-même afin de développer un projet de sécurité collective en Europe, collectivement garanti et visant l’équilibre et la paix ;
- consciente du rôle qu'elle aura à jouer à l'avenir pour sa propre sécurité et pour l'équilibre pacifique des puissances et des alliances, l'Europe entamera immédiatement un processus sérieux d'unification, en matière de politique générale et de défense, même sur une base partielle des membres qui entendent l'adopter ;
- le renforcement de la défense européenne, qui se développera sur la base du plus large partage industriel et stratégique, ne sera pas conçu contre un adversaire qui ne manifeste pas d'intentions hostiles, mais sera compris comme un instrument d'équilibre politique et militaire entre des pays et des groupes de pays qui souhaitent un développement pacifique des relations internationales ;
- malgré les mérites de la défense, l’Europe mettra l’instrument militaire au service de la diplomatie et de l’approche négociatrice des relations internationales ;
- L’Europe, en respectant et en réaffirmant ses principes fondateurs, poursuit la paix et la collaboration, ainsi que l’unité de but nécessaire pour résoudre les problèmes mondiaux.
Dans un tel cadre, qui combinerait l'indispensable réalisme avec la noblesse des principes, les besoins politiques et militaires avec le lancement d'un véritable projet unitaire, le pragmatisme imposé par les faits avec la vision idéale, un dialogue avec les Américains et les Russes devrait être engagé immédiatement. Sans l’arrogance de la puce, conscient des termes politiques minimaux et de la marginalité dans laquelle l’Union européenne est tombée après des décennies de bêtises, mais récupérant le bagage d’idées, de principes, d’attitude de dialogue que l’Europe possède aussi et dont elle a parfois fait preuve.
Aussi parce que, tandis que nous préparons l’avenir, et étant donné que les adversaires de l’Europe sont désormais des deux côtés, nous ne pouvons pas nous empêcher de parler avec les deux, pour éviter de finir écrasés ; Si on le place au niveau de la confrontation armée, ou de la dissuasion, et en supposant qu'on commence à y travailler immédiatement, cela prendra au moins dix ans.
Mario Boffo, 12 mars 2025
in Transform! italia